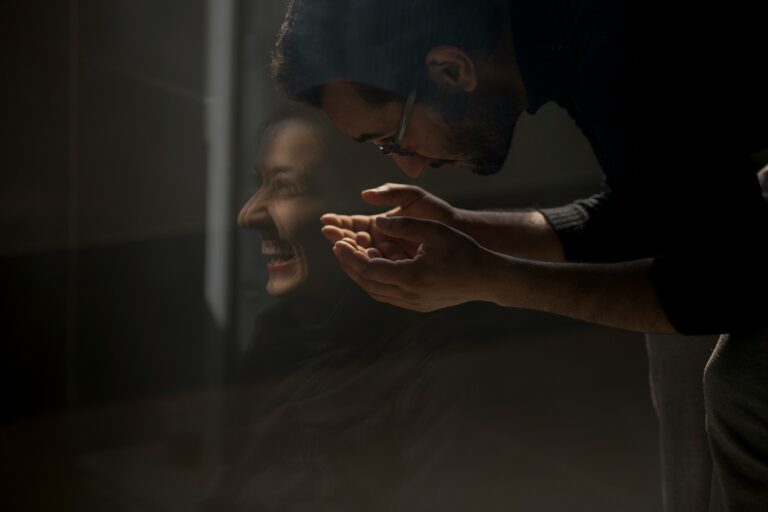
Bernard Duez (1) et Christiane Duez (2)
(1) Bernard Duez : Psychologue clinicien, psychanalyste, psychodramatiste. Formateur au psychodrame psychanalytique de groupe. Ancien Professeur de psychopathologie et psychologie clinique. Centre de Recherches en Psychopathologie et Psychologie Clinique Université Lumière Lyon2. Société Française Psychothérapie Psychanalytique de Groupe. Société de Psychanalyse Freudienne.
(2) Christiane Duez : Psychologue clinicienne, psychanalyste, psychodramatiste. Formatrice au psychodrame psychanalytique de groupe. Société Française Psychothérapie Psychanalytique de Groupe. Société de Psychanalyse Freudienne.
Résumé
Ce texte présente les empiètements que provoquent des catastrophes sociétales dans le travail psychanalytique dans les groupes. Les auteurs exposent les particularités du travail avec des groupes confrontés à la destructivité, sous forme insidieuse à l’égard des professionnels dans les institutions, sous forme de destructivité généralisée dans le terrorisme et les particularités du travail groupal pendant la pandémie de la covid 19. Ils montrent comment les différents groupes ont élaboré puis transformé ces menaces en s’étayant sur le groupe, sur la scène groupale, et sur le travail des transformations psychiques subjectives et groupales lors des transferts d’une mode de figuration à un autre : libre-association, création groupale de l’histoire, narration de l’histoire, répartition des rôles, mise en jeu théâtral et reprise groupale après-coup des éprouvés subjectifs, intersubjectifs, groupaux.
Mots-Clés : psychodrame psychanalytique de groupe ; transfert topique; situations limites; libre-associations dans les groupes; fonctions transformationnelles des changements de figuration; la fonction du jeu.
Après avoir eu l’occasion de nous former avec des psychodramatistes qui participaient au groupe de recherche du C.E.F.F.R.A.P., nous avons été conduits à mettre en place ce dispositif avec des enfants, des adolescents et de jeunes adultes. Au cours de cette pratique, nous avons apporté aux dispositifs historiques quelques modifications que nous présentons ci-dessous. Ces modifications sont liées à la pratique du psychodrame psychanalytique de groupe avec des patients présentant des problématiques archaïques et/ou une souffrance psychique en lien avec des problématiques d’intégration sociale. (Migration, habitat dans des « cités à problème », déqualification sociale des images parentales dans le cadre de chômage prolongé et/ou aliénations dans des réseaux délinquants…).
Après que ce dispositif révisé ait été utilisé dans la formation clinique des étudiants en psychologie, il nous a été demandé de mettre en place une formation professionnelle au psychodrame psychanalytique de groupe à destination des psychologues et travailleurs sociaux. Après quelques années, la demande s’est élargie et nous avons accueilli des professionnels du monde de l’entreprise, principalement des responsables des ressources humaines et plus récemment des professionnels du monde du spectacle.
Peu à peu, il est apparu que la demande de formation s’inscrivait non seulement dans une perspective d’élargissement des compétences, mais aussi pour répondre à :
Une insatisfaction quant aux effets thérapeutiques des dispositifs « individuels » avec les nouvelles formes de souffrance psychiques.
Une souffrance psychique des professionnels en rapport avec les conditions d’exercice de leur travail, ils cherchaient un lieu où ils pourraient mettre en travail groupalement les vécus et affects douloureux.
C’est en recoupant ces différentes expériences que nous avons pu prendre la mesure de l’impact des enjeux et traumatismes sociétaux sur le travail psychanalytique dans les groupes. Nous nous appuierons sur cette clinique.
Présentation du psychodrame psychanalytique de groupe
Le psychodrame psychanalytique de groupe est un dispositif groupal thérapeutique ou de formation.
La proposition de travail faite aux participants est présentée avec l’énoncé de la consigne suivante :
« À partir de la première idée qui vous vient, vous construisez ensemble une histoire – avec un début, un déroulement, une fin. Quand vous vous serez suffisamment mis d’accord sur l’histoire, vous vous répartirez les rôles pour pouvoir la jouer en faisant semblant comme au théâtre et en évitant de vous toucher. Lorsque vous estimerez l’histoire suffisamment jouée, nous reviendrons pour échanger tous ensemble sur ce que ce jeu vous aura fait éprouver à chacun et au groupe, ici et maintenant. »
Le psychodrame comporte donc trois étapes, la construction de l’histoire, la répartition des rôles et le temps de jeu, la reprise élaboratrice par les participants et les analystes.
Ce dispositif reprend l’essentiel de la première élaboration par les analystes du C.E.F.F.R.A.P.
- Les règles du psychodrame psychanalytique de groupe:
Ces règles, héritées de la pratique psychanalytique, ont été adaptées au dispositif du psychodrame psychanalytique de groupe.
La règle d’abstinence régit les liens entre les psychodramatistes et les participants et les liens des participants entre eux.
Les échanges entre les participants pendant les sessions se font sur le mode de la libre parole de chacun et de la libre association individuelle et groupale dans la parole et dans le jeu (improvisation).
Les échanges entre les participants qui pourraient avoir lieu entre les séances et qui concernent le groupe sont soumis à la règle de restitution : ils s’engagent à rapporter les discussions qui concernent notre travail.
Les liens entre les participants et l’extérieur sont régis par la règle de discrétion.
Nos sessions de formation au psychodrame psychanalytique de groupe se déroulent selon plusieurs temps qui se déploient et s’appuient sur les différentes modalités que propose ce dispositif, dans le respect au plus près du cadre psychanalytique avec les modifications liées au dispositif.
- Déroulement d’une séance de psychodrame de formation
Le premier temps de rencontre se joue fréquemment autour de la mise en place de l’espace dans la salle qui nous accueille. (Disposition des chaises en cercle, dégagement d’un espace de jeu.). Après les civilités, lorsque chacun a pris place, les échanges entre les participants s’engagent.
C’est un temps d’accueil au cours duquel les participants parlent librement de leur vécu des sessions précédentes, mais aussi des évènements qu’ils ont envie de partager avec les autres participants. Ces échanges créent un espace potentiel (D. W. Winnicott, 1975) et en résonance fantasmatique (Ezriel, 1950). Les contenus, les rythmes, voire les sonorités et les silences alternent. Peu à peu s’instaure une situation pré-transférentielle. Attentifs à ces échanges, nous intervenons peu, nous sommes dans une position d’attention également flottante.
L’énoncé de la consigne initie un nouveau temps, celui de la création d’une histoire. Les libres associations groupales surgissent. Les liens se tissent entre les différentes suggestions, créant fréquemment des effets de surprise. Facilement ou laborieusement s’élabore une histoire qui convient suffisamment à tous et à chacun. Une question partagée émerge « qui jouerait qui ou quoi ? ».
Ce temps du choix des rôles ou des personnages confronte chacun des participants à la façon dont il compte s’inscrire dans le jeu à venir. Nous rappelons régulièrement aux participants qu’ils choisissent leur rôle, qu’en aucun cas un rôle ne peut être imposé, qu’ils peuvent choisir de ne pas jouer et d’être observateurs. Nous rappelons également la possibilité pour les observateurs d’intervenir dans le jeu en improvisation. En ce qui concerne les animateurs, les participants savent qu’ils peuvent demander à l’un de nous de jouer et que nous accepterons le rôle. L’un de nous peut aussi intervenir dans le jeu (nouveau rôle, soutien ou voix off). Le choix des rôles confronte les participants à deux formes de choix : les choix désirés et les choix par défaut faits en fonction des nécessités de l’histoire.
Le temps de jeu peut commencer. Les participants se déplacent vers l’aire de jeu, les observateurs et animateurs reculent les chaises pour faire face au jeu et donner un espace suffisant à la scène. Cette organisation de l’espace indique à tous l’ouverture de l’espace-temps du jeu.
« En faisant semblant comme au théâtre », le jeu peut commencer. Les séquences cliniques présentées nous amèneront à évoquer l’importance de la figuration corporelle et de l’occupation et de l’utilisation de l’espace. Lorsque les acteurs considèrent qu’ils ont « joué suffisamment l’histoire », ils reviennent vers les observateurs et nous reprenons la première disposition de la salle (chaises en cercle).
Le dernier temps de cette séance commence avec la reprise après-coup des vécus de chacun et du groupe pendant le jeu. Immanquablement, ce temps de reprise élaboratrice est marqué par la surprise que les stagiaires ont éprouvée entre la première idée surgie en association, l’histoire collectivement construite, et le déroulement du jeu. Ils sont notamment étonnés des écarts et des effets d’étrangeté entre l’histoire telle qu’ils se la représentaient et le jeu, entre le rôle tel qu’ils se le représentaient et la façon dont ils l’ont joué, soit spontanément, soit « induit » par le jeu des autres acteurs. Ils se trouvent confrontés à départager dans ce changement, ce qui relève d’une contrainte intrapsychique subjective, ce qui relève des résonances fantasmatiques inconscientes des autres participants du groupe et ce qui relève de l’appareillage psychique du groupe, par exemple, fonctionnement en hypothèses de bases, prégnance de la mentalité primitive (Bion W.R. 1961). En résonance avec ce temps d’échange spontané et partagé, nous intervenons souvent pour permettre de réélaborer ce que cela évoque à chacun, ce que cela évoque pour le groupe, ici et maintenant. Eventuellement, nous faisons le lien avec les élaborations précédentes avec l’histoire et l’évolution du groupe.
Dans le cadre de ce dispositif, au fil des années, nous avons été amenés à traiter dans le groupe les interférences d’évènements traumatiques sociétaux particulièrement dramatiques. Le point commun entre les différents évènements traumatiques sociétaux que nous allons évoquer est que chacun de nous peut s’y trouver confronté personnellement.
Les interférences dans le psychodrame de trois situations traumatiques récentes
De la destructivité insidieuse à la destructivité radicale…
Nous évoquerons l’émergence de la violence destructrice dans le management et la gestion des institutions et des entreprises depuis une quinzaine d’années. Ces vécus collectifs et sociétaux de maltraitance confrontaient nos participants à des carences institutionnelles ne permettant pas de respecter l’éthique du travail. Le respect de cette éthique entrainait la mise en doute de leur efficacité, voire de leurs compétences professionnelles par les autorités de tutelle et enfin des menaces sur leur emploi.
Nous évoquerons les actes terroristes qui ont endeuillé la France à partir de 2015, confrontant chacun au risque que lui ou ses proches soit brutalement concerné par ces situations traumatogènes.
Nous évoquerons enfin la pandémie de la covid qui nous a fait vivre l’expérience d’une menace létale actuelle dans l’ici et maintenant des sessions de psychodrame.
Les maltraitances sociétales institutionnelles
Concernant les attaques idéologiques sur la compétence des soignants se référant à la psychanalyse, elles étaient déposées généralement pendant le temps d’accueil au cours des échanges spontanés entre les stagiaires. Les échanges pendant le temps d’accueil avaient une tonalité dépressive partagée par tous. Ceux qui n’étaient pas directement concernés faisaient aussi des liens avec l’ambiance de malêtre social. Les jeux qui émergeaient dans la suite de ces premiers échanges mettaient en scène des voyages chaotiques, des jeux de sélection professionnelle avec mise en âpre concurrence des candidats, les inévitables repas de famille marqués par des « invités » qui surgissent d’on ne sait où et viennent attaquer les liens existants. Le malêtre exprimé par les personnages est souvent bien au-delà de ce que le rôle demandait. Les personnages étaient malmenés, s’échappaient de leurs rôles amenant des réactions vives de la part des autres acteurs qui ne comprenaient pas le décalage avec l’histoire construite par le groupe. Malgré le contenu chaotique du déroulement de l’histoire et du jeu, les acteurs du jeu essayaient de le conclure par un « happy end » tout aussi décalé : par exemple, un conseil d’administration censé conduire à la fermeture de l’entreprise se termine en fête et en chansons…
Dans les associations d’après le temps de jeu, plusieurs dimensions sont apparues que nous reprendrons ultérieurement.
Menace et terreur
Le coup de tonnerre qu’a représenté pour la plupart de nos stagiaires l’attentat contre « Charlie Hebdo » en janvier 2015 a été d’autant plus violent que pour eux, compte tenu de leur âge, c’était la première fois qu’ils étaient directement confrontés à un acte terroriste, ici même en France. Ils ne pouvaient avoir le souvenir d’autres attentats meurtriers que certains plus âgés pouvaient, comme nous, avoir en mémoire (Attentat de la rue des rosiers, le 9 août 1982 à Paris, la série d’attentats terroristes à Paris entre le 25 juillet 1995 et le 17 octobre 1995 et puis en décembre 1996 dans les transports parisiens et certains grands magasins). Pour beaucoup vu leur jeune âge au moment de ces évènements, ceux-ci appartenaient déjà à l’histoire pour autant que leurs proches n’aient pas été concernés. Même les attentats contre le « World Trade Center » du 11 septembre 2001 appartenaient à une histoire traumatique partagée dans leur environnement, mais Ailleurs.
Au cours de cette année 2015, les stagiaires ont été confrontés par deux fois à la survenue d’attentats d’une extrême violence. La première session de l’année en mars a lieu deux mois après l’attentat de Charlie Hebdo et l’hypermarché casher. Lors de la première séance de cette session, l’évènement qui a mobilisé la France entière et au-delà, est rapporté par nos stagiaires. S’ils sont choqués par la violence des attentats, ils sont suffisamment à distance pour l’intégrer et le travailler dans le cadre du dispositif. Les jeux en porteront la marque sous la forme d’interrogation de personnages bizarres, notamment quand ceux-ci se surajoutent par rapport à ce qui avait été prévu dans la construction de l’histoire. Par exemple, une personne s’invente un rôle d’étrange ermite qui surgit sur le chemin des randonneurs et que ceux-ci malmènent, car ils ne comprennent rien à ce qu’il fait là. Un autre jeu met en scène un groupe qui se retrouve échoué sur une île et ne sait si les indigènes veulent les accueillir ou les dévorer (happy end improvisé). L’évènement infiltre le contenu des jeux sans les paralyser.
Le 13 novembre 2015, Paris est secoué le même soir par les attentats du Bataclan, du stade de France et du mitraillage de plusieurs terrasses de café. Notre session de formation a lieu quelques jours après. Le temps d’accueil débute par un très long silence. Nos participants sont figés. Personne n’ose prendre la parole pour évoquer ce qui occupe la pensée de chacun. L’un d’entre eux enfin prend la parole pour évoquer ce qui s’est passé et souligne la répétition avec ce qui s’est vécu au mois de janvier. Un autre stagiaire prend à son tour la parole pour dire qu’un ami très proche était au Bataclan et que pendant longtemps il n’a pas su s’il faisait partie des victimes. Très vite, d’autres évoquent des connaissances qui se sont trouvées concernées par l’un des trois attentats. Ces attentats ont touché des personnes plus ou moins proches pour quasiment tous les participants. Le partage de l’horreur de ces actes devient un objet commun qu’ils vont tenter « d’exorciser » tout au long de la première partie de la matinée jusqu’à la pause. Le spectre de la répétition et de la menace du « tous concernés » hante leurs échanges. Il apparaît notamment que l’organisation minutieuse des attentats laisse planer pour chacun la menace anxiogène d’une terreur sans fin. Pendant la pause les échanges ont continué entre eux poursuivant le travail d’élaboration. De retour dans la salle, selon la règle de restitution, ils communiquent leurs échanges. Ce flot de paroles échangées a permis de diffracter la sidération initiale ; ils continuent d’en parler, mais de façon plus fluente. Nous nous autorisons enfin à leur proposer d’inventer une histoire. L’appel à l’invention de l’histoire provoque un soulagement. L’histoire est construite très rapidement. La volonté d’évasion, de fuite de ce réel mortifère apparaît de suite : très vite, ils partent en voyage ! Les autres jeux de la session s’autoriseront à des tonalités plus graves ou marquées par des accidents, des randonnées dangereuses ; ils venaient convoquer dans le jeu les affects qui les avaient envahis tout au long de la matinée en tentant d’en prendre la mesure dans des situations variées où les autres pouvaient avoir un rôle réparateur. Au-delà de la mise en jeu des histoires élaborées entre eux, des évènements surviennent brutalement dans le cours du jeu, sans que cela puisse être anticipé, mettant en travail leur vécu lié à la brutalité soudaine et dévastatrice des attentats.
Nous retrouverons sous une forme plus ou moins manifeste des résurgences de ces évènements tant du côté des effets immédiats de sidération que du côté des effets des élaborations après-coup dans la constitution de l’appareillage psychique groupal.
Covid 19 : n’importe qui peut être concerné
Par rapport aux actes terroristes, l’intensité de la menace se trouve diffractée du fait que chacun peut être porteur et victime du virus même à son insu. La pandémie s’est installée insidieusement, peu à peu, de façon envahissante, contraignant chacun à restreindre volontairement ou de façon imposée son espace quotidien. Nous étions en présence d’une progression d’une menace vitale face à la laquelle aucune fuite n’est possible. À la différence des actes terroristes dont on peut penser qu’une fois qu’ils ont été perpétrés, ils ne se répéteront pas systématiquement dans la durée, la pandémie s’est installée dans une répétition de plus en plus menaçante au fil du temps. L’immobilisation imposée à la fois par les autorités sanitaires et la maladie a contraint chacun à un repli sur soi. Le confinement a créé une situation paradoxale dans le rapport aux autres entre évitement et préoccupation bienveillante.
La conduite du psychodrame pendant la pandémie nous a confrontés à une situation totalement inédite par rapport au cadre institutionnel, au déroulement temporel, et bien sûr au contenu des séances.
Le cadre institutionnel est d’emblée modifié dès le début de la pandémie. La première séance se déroule au moment où le confinement vient d’être décidé. Étant donné l’organisation et l’éloignement de beaucoup de stagiaires, la session ne peut pas être annulée. Conformément aux règles sanitaires (autorisation de la réunion de petits groupes), elle va avoir lieu dans l’institution qui l’accueille habituellement, mais qui est alors totalement désertée. Le vide des locaux, l’éloignement exigé des sièges, le port du masque créent une ambiance d’une pesante étrangeté. Il y a un authentique effet de déréalisation. Cet effet est d’autant plus prégnant qu’il s’agit de la première séance de l’année, séance d’accueil des nouveaux participants dans ce groupe semi-ouvert. Pour les anciens, la situation est « bizarre », mais pour les nouveaux arrivants elle est totalement étrange. Dans une forme de contrat inconscient, malgré la taille de la salle, les participants vont préserver un écart, qui sans être aussi exigeant que les normes officielles, n’en est pas moins beaucoup plus important que d’habitude. Après la présentation du dispositif, d’un commun accord, nous décidons de nous démasquer un court instant afin que chacun puisse se représenter le visage de l’autre. Cet acte symbolique a été d’une grande importance en mettant en scène la dimension contractuelle de co-construction et d’appropriation du cadre. Ce cadre intérieur du dispositif rendait possible le travail du psychodrame psychanalytique de groupe dans ce contexte très particulier. Cette légère entorse aux consignes sanitaires va créer le lien nécessaire et suffisant pour que le travail s’engage et se démarque de cet environnement « hostile ».
Les modifications du cadre vont se succéder au rythme de l’évolution de la pandémie. La session suivante sera suspendue, car le confinement est total. Il va s’en suivre un déroulement chaotique lié aux avatars de la pandémie : changement de lieu, car les locaux habituels sont fermés, changement de calendrier avec des sessions très éloignées puis très rapprochées dans le temps. Au début de chaque session, l’inquiétude est de savoir qui sera là, qui sera absent, malade ou à l’isolement comme cas-contact. Le moindre retard de l’un ou l’autre provoque l’inquiétude partagée du groupe.
Dans ce contexte de menace généralisée lié à la pandémie vécue par tous et chacun, la potentialité traumatique a d’emblée été mise en travail par le groupe, dès les premiers échanges, dans les jeux, conduisant les participants à partager et élaborer leur vécu singulier dans le rapport à cette menace. Les premiers échanges évoquent de façon très réaliste les impacts de cet environnement sur chacun. Ils partagent leurs inquiétudes par rapport à tel ou tel collègue, ami ou famille touchés par la maladie, leurs aménagements nécessaires du quotidien… ceci permet un partage qui redessine lors de chaque session l’espace psychique groupal, ici et maintenant. La co-construction permanente du cadre assure à chacun l’étayage bienveillant, nécessaire et suffisant, sur le groupe qui va permettre les libres associations singulières et groupales.
Lors de l’énoncé de la consigne, les anciens vont signaler aux arrivants que « l’évitement du toucher » existait déjà avant la covid. Cette remarque illustre le travail auquel le groupe est soumis du fait de la situation étrange : il s’agit de différencier ce qui existait auparavant, ce qui perdure et ce qui acquiert un nouveau sens. Dans le cas présent, la consigne « de ne pas se toucher » apparaît comme une fonction protectrice, que ce soit au niveau de la menace sanitaire immédiate, mais aussi et surtout comme une fonction de respect de l’intimité de chacun dès la première séance.
Passé le premier temps d’étrangeté, la construction des histoires, parfois laborieuse, est ponctuée par des traits d’humour saisissants qui provoquent des fous rires partagés. Il en résulte des scénarii dont la trame semble bien banale par rapport à l’environnement dans lequel se déroulent les sessions. Par contre, la mise en jeu des histoires construites ensemble revêt une tonalité tout à fait particulière, car ce sont souvent des scènes apaisées, par exemple, les jeux de repas de famille se transforment. Alors qu’ils sont habituellement occasion de jouer des scènes conflictuelles dans lesquelles chacun dépose des éléments appartenant à son histoire, dans cette période, si le jeu des conflits existe, en revanche ceux-ci sont traités avec davantage de bienveillance, le souci de ne pas mettre l’autre en difficulté est très présent. On peut constater la présence beaucoup plus importante des aïeux. Ceci peut se comprendre dans le rapport transférentiel avec les animateurs, mais aussi dans une mise en scène de la survivance de toutes les générations, malgré les absences dans les sessions du groupe de participants touchés par la covid. Dans le temps du jeu, les absents sont régulièrement évoqués soit en rappelant une de leurs interventions soit en constatant que « si lui ou elle avait été là, c’est sûrement le rôle qu’il aurait choisi ».
D’autres jeux s’articulent autour de fêtes de village, de fêtes foraines, avec beaucoup d’inventivité et de sentiments joyeux exprimés. Cela s’accompagnait de moments d’expressions bruyantes ou très motrices où, dans la vacuité de l’espace institutionnel, ils s’assuraient de leur survie personnelle et collective. L’idée de danser sur un volcan est revenue régulièrement dans les associations groupales. L’attention particulière portée à l’autre venait suppléer un environnement vécu comme peu fiable, voire angoissant.
Une oscillation constante entre prégnance de la menace létale et maintien des liens autour de la vie s’est manifestée dans les jeux tout au long de ces sessions.
De l’interférence à la Perlaboration des évènements traumatiques
L’énoncé dans la consigne : « Lorsque vous estimerez l’histoire suffisamment jouée, nous reviendrons pour échanger tous ensemble sur ce que ce jeu vous aura fait éprouver à chacun et au groupe ici et maintenant. » ouvre le troisième temps de reprise après-coup et d’élaboration.
Par rapport aux évènements traumatiques, ces temps de reprises ont fait apparaître des constantes et des variables dans les éprouvés et les élaborations.
Les constantes :
Lorsque les évènements sociaux ne présentent pas une potentialité traumatique et que les stagiaires reprennent place dans l’espace de parole, les premiers échanges portent régulièrement sur le jeu, les étonnements, les éprouvés, les remarques sur le déroulement du jeu.
Pendant les sessions marquées par ces évènements traumatiques, ces premiers échanges ont constamment été marqués d’un intense sentiment de soulagement. Le groupe est vécu comme un espace-dépôt disponible et partagé. Dans les échanges qui suivent apparaît un fort éprouvé d’identification d’appartenance au groupe lié au vécu d’appropriation collective du jeu comme objet créé et partagé (Rouchy J C., 1990), (J. B. Pontalis, 1963). Dans cette même dynamique, joueurs et observateurs prennent conscience que, pendant la construction de l’histoire, l’expression par les décalages (les idées « bizarres ») qui fusent en première association, puis l’humour, y compris l’humour noir, font partie de cet essai de dégagement du traumatique et ils réalisent que la fin de l’histoire introuvable ou la précipitation à conclure portent les traces de la menace. Le jeu est évoqué comme une chance donnée à tous et à chacun d’extérioriser leurs vécus d’angoisse par le faire-semblant, en les relativisant dans l’espace potentiel d’illusion du jeu (D. W. Winnicott, 1971), même si ces vécus ne perdent rien de leur actualité. L’expression par le corps dans le jeu : excès de replis et débordements moteurs, mimiques, jeu très théâtralisé témoignent alors pour eux de leur survivance dans cet espace-temps d’illusion qui leur ouvre d’autres potentialités.
Les variables :
- Pour les maltraitances institutionnelles :
Comme cela a été évoqué dans les jeux proposés et joués par les stagiaires, le lien avec la réalité institutionnelle et sociétale apparaît avec plus d’évidence. Ils prennent conscience dans la reprise que l’incompréhension, la colère, les expressions de vécus dépressifs joués par les acteurs sont très proches de ceux qu’ils ont pu vivre eux-mêmes dans des situations de maltraitance institutionnelles. Les échanges leur permettent de s’approprier en leur nom propre les différentes façons de réagir immédiatement qui parfois ont pu les surprendre dans la vie professionnelle. Ils découvrent combien leur investissement personnel dans ces professions est malmené par les attaques. Dans le groupe, les évocations de ces situations entrent en résonance avec le vécu de chacun. Dans les autres situations à potentialité traumatique que nous évoquons, la peur est présente, mais l’attaque sur le narcissisme est absente. Chacun découvre qu’il peut être concerné par l’attaque sur les compétences, la confrontation à la carence, la colonisation idéologique sur fond de « contraintes économiques ». À travers leurs échanges, ils perçoivent que le vécu dépressif qui s’ensuit s’apparente bien souvent à un vécu mélancoliforme et que l’attaque sur les compétences, qui leur est adressée répétitivement, finit par insinuer et créer le doute pendant qu’elle sème également le trouble et le dysfonctionnement dans les équipes. Ils réalisent alors que le choix de cette formation correspond à une réponse à plusieurs niveaux : une augmentation des compétences, un espace où pouvoir se ressourcer en partageant avec d’autres professionnels, une affirmation d’identité professionnelle. Ce dernier point les conduit à découvrir l’intimité qui entre en jeu dans leur identification d’appartenance professionnelle (Rouchy J. C. 1990).
- Pour les attentats :
Les échanges, dans l’après-coup des jeux, commençaient spontanément. Les acteurs et les observateurs soulignaient très vite comment les incidents ou accidents joués leur avaient permis de représenter et de se représenter ce que la violence et la soudaineté des actes terroristes avaient suscité pour chacun et collectivement pour tous. Par-delà leurs différentes identifications d’appartenance familiales, culturelles, professionnelles, ils prenaient conscience de comment le groupe les co-étayait, ici et maintenant. L’élaboration groupale des réactions de chacun, face aux incidents inopinés qu’ils avaient rencontrés ou créés pendant les jeux, permettait de mettre en scène, en évidence, la façon dont ils vivaient le désarroi face à des actes qui, sans les viser personnellement, relevaient d’une intention meurtrière qui pouvait les atteindre. Ils s’autorisèrent à exprimer leur peur pour eux-mêmes, pour leurs proches et globalement pour tous, ainsi que les valeurs qui garantissent les liens d’humanité dans nos sociétés.
- Pour la covid 19 :
Le retour dans l’espace de parole s’accompagnait d’un soin particulier à maintenir l’écart entre les chaises que nous avions dû déplacer afin de libérer suffisamment l’espace de la scène de jeu. Ceci mettait en jeu le souci permanent des stagiaires face à la menace que chacun pouvait représenter à son insu. L’élaboration après-coup faisait apparaître une difficulté pesante à se dégager du jeu lui-même souvent marqué par des histoires sans fin. Les échanges achoppaient sur des détails du déroulement que l’on pourrait résumer avec leurs mots :« on ne sait pas où ça va ». Dans les premiers temps de la pandémie, les échanges après le jeu restaient superficiels ; il était perceptible que quelque chose n’arrivait pas à s’exprimer. Il était alors nécessaire que les animateurs pointent le lien possible avec l’actualité qui envahissait insidieusement la vie de chacun y compris la nôtre. La parole pouvait alors se libérer. Ils découvrirent que les histoires sans fin mettaient en scène à la fois la menace d’une fin létale, mais aussi le désir que cette fin ne survienne pas. L’expression répétitive « on ne sait pas où ça va » représentait bien l’expression du vécu face à ce virus dont on ne savait pas où il allait et comment il pouvait infecter quiconque, y compris à son insu. Ceci était d’autant plus vrai que ces sessions furent marquées par des absences liées à la contamination virale.
Apports du psychodrame psychanalytique de groupe
La rencontre dans la vie quotidienne de situations traumatogènes partagées par les patients ou les stagiaires et les psychanalystes impacte les sessions de psychodrame psychanalytique de groupe. D’autres exemples auraient pu être proposés : la guerre en Europe, les instabilités politiques nationales et internationales, l’importance prise par les nouveaux supports de lien comme internet et les réseaux sociaux qui viennent troubler les rapports d’intimité. Nous avons choisi des situations qui touchaient immédiatement le quotidien de nos stagiaires, la première, une situation de maltraitance sociétale, la seconde présente les impacts de l’explosion de la violence dans la société et la troisième qui renvoie tous et chacun à l’angoisse de la confrontation à une menace létale.
La particularité du psychodrame psychanalytique de groupe est de déployer l’ensemble des liens possibles dans le groupe comme scène psychique disponible et partagée par chacun et par tous. La spécificité de ce dispositif est son déroulement en trois temps, celui de l’appel à la libre association dans les premiers échanges puis dans la construction de l’histoire, le temps de répartition des rôles et du jeu et enfin la reliaison de l’ensemble dans l’élaboration après-coup.
La mise à disposition initiale de cette scène relève du travail des psychanalystes, elle permet à chacun et à tous de se représenter l’espace-temps dans lequel ils vont s’inscrire. En réponse à la mise à disposition du groupe des différentes formes de figuration dans le psychodrame, les participants s’engagent à leur insu dans un travail d’autoreprésentation collective de ces différentes figurations et de leurs liens entre elles. Au cours de ce travail, les participants découvrent la place très importante de la fonction de passage : passage de la libre association collective à la construction de l’histoire qui s’organise selon les règles de la narration, passage de la narration à la répartition des rôles qui ouvre la scène pour le jeu, passage du jeu théâtral au temps de la reprise groupale des éprouvés, des vécus singuliers et groupaux, ici et maintenant.
Dans chacune des situations exposées, nous pouvons remarquer que l’apaisement de l’intensité des affects, des différentes angoisses, des vécus d’immobilisation de la pensée, des menaces persécutives… s’est opéré grâce à la fonction transformationnelle de ces passages. Selon les différents chocs traumatiques, l’une ou l’autre de ces figurations a pris plus ou moins d’importance, mais ce sont les transformations que les participants ont expérimentées entre les différents temps du psychodrame psychanalytique de groupe qui leur ont permis de relativiser ce qui semblait impossible à vivre. Les participants exploitent la multitude des supports de figuration, en particulier pendant le temps de jeu où les différents rôles choisis et la façon dont l’histoire va être jouée produisent un travail semblable à celui du rêve (déplacement, condensation, diffraction, retournement…), ils entrent dans un travail de régrédience qui permet à travers les figurations différentes de construire une forme d’espace onirique commun. Nous retrouvons la célèbre formule de D. Anzieu (ibidem) « on entre en groupe, comme on entre en rêve ». Dans le temps après-coup, beaucoup sont étonnés, voire stupéfaits, de la proximité des éprouvés au cours du jeu avec ceux vécus dans les rencontres traumatogènes.
Conclusion
Nous pouvons considérer, dès lors, que ces transformations sont le résultat de la mise en travail par le processus de transfert des liens à l’égard des psychodramatistes, mais également des autres participants et des processus de transfert qui sous-tendent le travail dans l’appareil psychique groupal. La spécificité du transfert dans les groupes et plus encore dans le psychodrame psychanalytique de groupe est la diffraction du transfert et plus particulièrement les manifestations du transfert topique fonctionnant en diffraction/retournements qui est selon nous un moteur de l’appareillage psychique groupal (Duez B., 1988, 2000, 2006, 2009). La diffraction du destin des actualisations pulsionnelles vers tout figurant autre, ou groupe d’autres, actuellement présents s’apparente à la figurabilité du rêve (Kaës R., 1976) tout comme le retournement sous toutes ses formes (régrédience pulsionnelle, retournement sur la personne propre, inversion dans le contraire, activité-passivité, subi-agi, …). Ce transfert topique va permettre de tramer les groupes internes (Kaës R., ibidem) en une topique subjectale et groupale. Le dispositif de psychodrame nous montre que ces deux modes sont solidaires et nécessairement liés. Ce transfert est un processus originaire. Il constitue la primitive du transfert sur le lien. Il est au cœur de l’efficacité symbolique (C. Lévi-Strauss, 1958) de l’approche psychanalytique des groupes dans les prises en charge des traumatismes et souffrances sociétales les plus archaïques. Si cette modalité de transfert est à l’œuvre dans d’autres dispositifs psychanalytiques de groupe, il trouve sa pleine extension dans le psychodrame psychanalytique de groupe du fait de la multiplicité et la variété des supports de figuration liés par l’élaboration à partir de « l’ici et maintenant ».
Bibliographie
Anzieu, D. (1975). Le groupe et l’inconscient. Paris : Dunod.
Bion, W. R. (1961). Recherches sur les petits groupes. Paris : P.U.F., 1965.
Duez, B. (1988). La Primitivité symbolique : pour une analyse de l’anti-sociabilité dans les sciences humaines (thèse de doctorat sous la direction du Pr. H. Beauchesne, Université Paris V). Paris.
Tome 1 : Clinique psychanalytique groupale de l’anti-socialité et critique méthodologique (406 p.).
Tome 2 : Les primitives de l’anti-socialité : métapsychologie psychanalytique et sciences humaines (287 p.).
Duez, B. (2000). De l’obscénalité du transfert au complexe de l’Autre. In J. B. Chapelier et coll. (Eds.), Le lien groupal à l’adolescence (pp. 59–112). Paris : Dunod.
Tr. it. : Dall’oscenità del transfert al complesso dell’altro. In Chapelier, J. B., Il legame gruppale nell’adolescenza (pp. 180–134). Roma : Borla, 2002.
Duez, B. (2006). Le transfert comme paradigme processuel de la groupalité psychique : de l’habitude au style. Revue de psychothérapie psychanalytique de groupe, 2, 31–50.
Duez, B. (2009). Transformations et transfigurabilité du processus transférentiel à l’adolescence. In Y. Morhain & R. Roussillon (Eds.), Actualités psychopathologiques de l’adolescence (pp. 189–218). Bruxelles : De Boeck.
Ezriel, H. (1950). A psychoanalytic approach of group treatment. British Journal of Medical Psychology, 23, 59–75.
Kaës, R. (1976). L’appareil psychique groupal. Paris : Dunod.
Kaës, R. (2007). Un singulier pluriel. Paris : Dunod.
Lévi-Strauss, C. (1958). L’efficacité symbolique. In L’anthropologie structurale (pp. 205–226). Paris : Plon.
Pontalis, J. B. (1963). « Le petit groupe comme objet ». In Après Freud (pp. 257–273). Paris : Gallimard, 1968.
Rouchy, J. C. (1990). Identification et groupe d’appartenance. Connexion, 55, 45–56.
Winnicott, D. W. (1971). Jeu et réalité (tr. Fr.). Paris : Gallimard, 1975.
